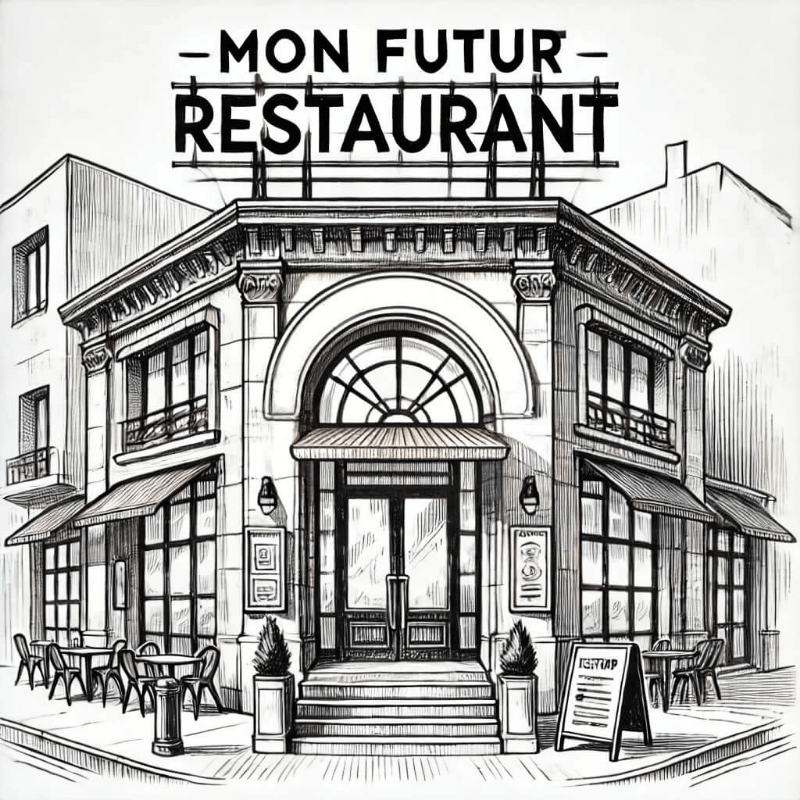Alors que la saison estivale touche à sa fin, de nombreux professionnels de la restauration…
Fréquentation des restaurants : un bilan contrasté à la rentrée 2025 en France

Un été 2025 morose pour les restaurants traditionnels
L’été 2025 a été difficile pour la restauration traditionnelle en France. Au niveau national, la fréquentation des restaurants en France a chuté d’environ 15 à 20 % par rapport à l’année précédente. Et parfois jusqu’à 25% selon les zones… Cette baisse marquée a été constatée aussi bien sur le littoral qu’en ville : en pleine saison estivale, de nombreux restaurateurs ont tiré la sonnette d’alarme en voyant leurs salles à moitié vides.
En cause ? L’inflation des prix et le budget vacances en berne pour de nombreux Français. Avec la hausse des tarifs des menus, beaucoup de clients ont réduit la voilure : « On se limite quand même beaucoup plus », témoigne une vacancière, qui préfère prendre un apéritif puis manger chez elle plutôt que de dîner au restaurant tous les soirs. Ce changement d’habitude est révélateur d’une tendance lourde : face à la vie chère, les vacanciers privilégient d’autres options moins coûteuses (pique-niques, plats à emporter, restauration rapide) et sortent moins souvent au restaurant.
Les statistiques confirment ce ressenti. Au bord de mer, la fréquentation a plongé de 15 % à 30 % selon les établissements, tant les prix parfois excessifs ont freiné la clientèle. En revanche, les restaurants de montagne et de campagne s’en sont mieux sortis, avec une activité stable voire en hausse, grâce à une offre restée plus raisonnable en termes de prix. Autrement dit, l’été a été à deux vitesses : les zones touristiques chères ont souffert, tandis que les destinations offrant un bon rapport qualité-prix ont limité la casse. « Certains établissements, notamment en bord de mer où les prix ont flambé, ont souffert lourdement. Mais d’autres ont fait une excellente saison, surtout en montagne et en campagne où l’offre est restée plus raisonnable », résume Bernard Boutboul du cabinet Gira.
De plus, cette conjoncture difficile a directement pesé sur les finances des restaurateurs : la rentabilité moyenne du secteur a chuté de 7 % en un an, d’après le cabinet Gira, sous l’effet cumulé de l’augmentation des coûts (matières premières, énergie, loyers), du remboursement des prêts COVID, de la pénurie de personnel et du recul du pouvoir d’achat des clients. Face à des marges qui fondent, certains restaurateurs n’ont eu d’autre choix que de réduire leurs effectifs. Par exemple, à Bordeaux, un établissement historique d’une soixantaine de couverts a dû supprimer cinq postes pour survivre à cette baisse d’activité « comme on n’en a jamais vu, même en 2008 ».
Une rentrée sous le signe de la prudence
Avec la fin des vacances d’été et le retour à la routine de septembre, le secteur espérait un sursaut de fréquentation. Qu’en est-il réellement à l’heure du premier bilan de la rentrée 2025 ?
D’après les dernières études de marché, la fréquentation s’est stabilisée en septembre. Environ 51 % des consommateurs déclaraient sortir au moins une fois par semaine ce mois-là, un niveau comparable à l’avant-saison estivale. Autrement dit, il n’y a pas eu d’effondrement supplémentaire de l’activité en cette rentrée. Une accalmie bienvenue après la tempête de l’été.
Certains professionnels observent même une légère reprise dans les centres-villes : « C’est dans la continuité de septembre. Une arrière-saison plutôt bonne », confie le gérant d’un restaurant en région Occitanie, après avoir vu un afflux de touristes pendant les vacances de la Toussaint. La météo clémente de l’automne et le retour d’une clientèle locale (actifs, étudiants) ont pu contribuer à remplir à nouveau certaines terrasses.
Pourtant, la prudence reste de mise. Les données de fréquentation montrent que ce léger mieux est fragile et inégal. Les sorties « autour d’un verre » ont fortement ralenti à la rentrée : on note 9 points de fréquentation en moins en septembre par rapport à août pour les occasions de type bar/afterwork. C’est le signe que les soirées estivales, souvent synonymes de verres en terrasse, ont fait place à un rythme plus modéré en automne. En parallèle, les habitudes de sortie se transforment : les afterworks et dîners progressent légèrement par rapport à l’an dernier (+2 à +3 % de fréquentation en soirée), tandis que la pause-déjeuner recule (-2 %).
Ce décalage peut s’expliquer par le télétravail (moins de déjeuners pris à l’extérieur) et par la recherche d’économies sur le repas du midi au profit d’occasions plus « plaisir » en fin de journée. Un restaurateur parisien note par exemple que sa formule du midi a nettement moins de succès qu’avant, alors que l’activité en soirée et en fin de semaine résiste mieux. Transition oblige, la rentrée 2025 n’a donc pas provoqué de rebond spectaculaire de la fréquentation, mais plutôt une stabilisation à bas niveau assortie de nouvelles habitudes de consommation.
Des Français plus sélectifs face à l’inflation
Si la fréquentation des restaurants en France reste en deçà des standards d’avant-crise, c’est en grande partie à cause du contexte économique. L’inflation pèse toujours sur le budget des ménages, incitant ces derniers à réévaluer leurs priorités de dépenses. « L’incertitude économique et politique fait que les gens revoient leurs priorités. Nous, on n’est pas une priorité vitale » constate ainsi le gérant d’une brasserie, lucide sur le fait que sortir dîner passe après d’autres postes de dépense obligatoires.
Concrètement, beaucoup de clients arbitrent différemment leurs loisirs : aller au restaurant devient occasionnel, réservé aux moments particuliers, tandis que pour le quotidien on se tourne vers des solutions moins onéreuses.
Une restauratrice du sud-ouest observe depuis le début de l’année une baisse de fréquentation globale, avec des salles souvent clairsemées en semaine : « Franchement, même la semaine dernière, les chaises étaient plutôt vides. C’est totalement variable : il y a des jours où on ne sait pas pourquoi on n’a personne, et le lendemain il y a plus de gens. C’est comme s’il n’y avait plus de règle » explique-t-elle, désemparée devant l’imprévisibilité de sa clientèle.
Les professionnels constatent également un changement dans le comportement des convives qui continuent de venir. Moins de sorties, mais des dépenses plus ciblées : on commande peut-être un plat unique plutôt qu’un menu complet, ou on renonce à l’entrée/dessert pour alléger l’addition.
Certains types d’établissements souffrent plus que d’autres : les restaurants traditionnels « à table » sont les grands perdants, au profit des offres moins chères. « On se restaure moins bien, ou moins, ou différemment. Et on fréquente moins ces restaurants traditionnels », résume Franck Chaumès, président de l’UMIH, qui s’alarme de voir « la restauration traditionnelle en train de disparaître » si la tendance se poursuit.
Les clients au portefeuille serré se reportent sur les fast-foods, la vente à emporter ou la cuisine maison, quitte à sacrifier le service et la convivialité qu’offre habituellement une brasserie ou un bouchon. À l’inverse, la clientèle à plus haut pouvoir d’achat maintient davantage ses habitudes de sorties, mais en se montrant plus exigeante sur la qualité de l’expérience.
Ce phénomène se traduit par un paradoxe relevé par plusieurs études : les Français sortent moins souvent, mais dépensent davantage en moyenne lorsqu’ils sortent. En effet, l’addition grimpe tandis que les visites se raréfient. Autrement dit, les consommateurs compensent la raréfaction de leurs sorties par une quête de qualité : ils sont prêts à payer le prix uniquement si l’expérience en vaut la peine. « La médiocrité ou la “normalité” ne suffisent plus à remplir une salle » dans ce contexte inédit.
Cette sélectivité accrue explique que, malgré les plaintes sur les prix, près de 8 clients sur 10 se disent satisfaits du rapport qualité-prix lors de leurs sorties. Ceux qui continuent à fréquenter les restaurants estiment généralement en avoir pour leur argent. Preuve que les établissements qui soignent la qualité, l’accueil et l’originalité parviennent à tirer leur épingle du jeu.
À l’inverse, les adresses au rapport qualité-prix jugé décevant risquent de faire les frais de cette nouvelle donne, les clients n’hésitant plus à « bouder » les tables qui ne correspondent plus à leurs attentes ou à leur budget.
Un secteur inquiet, mais combatif face aux défis
Du côté des professionnels, l’inquiétude demeure malgré quelques signaux encourageants à la rentrée. Beaucoup soulignent que la reprise est trop timide pour compenser la saison d’été médiocre. « Déjà cet été, ce n’était pas une saison aussi réussie qu’auparavant. On n’a rien pu mettre de côté. L’hiver sera rude ! » prédit un gérant, qui n’a pas pu constituer de trésorerie durant l’été et appréhende les mois froids à venir.
Il faut dire que les charges fixes continuent de courir (loyers commerciaux, factures d’énergie en hausse à l’approche de l’hiver) tandis que le flux de clients reste incertain. Chaque jour, 25 restaurants ferment en France faute de repreneur ou de rentabilité suffisante, selon l’UMIH. Sur l’ensemble de l’année écoulée, près de 8 900 établissements de l’hôtellerie-restauration ont connu une défaillance (faillite ou redressement) entre avril 2024 et avril 2025. C’est un record historique d’après la Banque de France.
Ces chiffres traduisent une crise profonde où beaucoup d’indépendants jettent l’éponge, épuisés par deux années de turbulences post-Covid couplées à de nouvelles contraintes économiques.
La concurrence accrue joue également un rôle : certaines villes ont vu une explosion du nombre de restaurants ces dernières années, ce qui répartit la clientèle sur plus d’adresses. « Il y a trois ans, on était trois restaurants dans la rue, aujourd’hui on est huit, alors que la population n’a pas augmenté » témoigne une restauratrice de province, illustrant une offre surabondante par rapport à la demande hors périodes touristiques.
Les nouvelles enseignes sont souvent des snackings ou fast-foods moins coûteux pour le client, face auxquels la restauration traditionnelle peine à s’aligner sur les prix sans compromettre la qualité. Cette concurrence des formats oblige les restaurateurs classiques à se réinventer pour attirer à nouveau les clients attablés.
Heureusement, le secteur ne reste pas les bras croisés. Conscients qu’il faut s’adapter pour survivre, de nombreux restaurateurs et organisations professionnelles multiplient les initiatives. Menus “anti-crise”, recettes plus simples et prix modérés font leur apparition sur les cartes pour attirer une clientèle en quête de bons plans.
Formules à partager (assiettes de tapas, planches à partager, cocktails dînatoires) sont proposées afin de booster la convivialité et de séduire les groupes d’amis ou les familles. Plusieurs établissements misent sur des happy hours et des offres promotionnelles ciblées (par exemple des réductions pour les étudiants ou les seniors en début de semaine) afin d’élargir leur base de clients, notamment chez les plus jeunes.
Parallèlement, on observe un développement de l’offre de snacking et de vente à emporter au sein même de restaurants traditionnels : il s’agit de capter la clientèle pressée le midi ou celle qui, par habitude prise pendant la pandémie, préfère emporter son repas.
Enfin, beaucoup insistent sur un retour aux fondamentaux : améliorer la qualité des produits, soigner l’accueil, garantir une hygiène irréprochable et veiller à la cohérence entre les prix et la valeur perçue. Ces éléments, parfois négligés sous la pression, redeviennent essentiels pour reconquérir la confiance de consommateurs désormais très attentifs au rapport qualité-prix. « Qualité et service : on revient aux basiques », résume un chef parisien qui a récemment réduit sa carte pour se concentrer sur quelques plats maîtrisés, à des tarifs plus doux.
Les organisations professionnelles appellent aussi à des mesures de soutien structurelles. L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH) milite par exemple pour prolonger au-delà de 2025 l’exonération fiscale des pourboires, une mesure mise en place pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés et encourager les vocations dans le métier.
Le syndicat porté par le chef Thierry Marx propose également d’instaurer une formation obligatoire pour toute nouvelle ouverture de restaurant. L’objectif ? Mieux outiller les futurs gérants sur les bases de la gestion d’entreprise, afin de réduire les échecs précoces et d’endiguer la prolifération d’adresses sans modèle économique solide. Ces pistes font débat, mais elles témoignent de la détermination du secteur à se réorganiser face à la crise.
Quelles perspectives pour les mois à venir ?
L’horizon reste incertain pour la restauration française, même si des motifs d’espoir existent. D’un côté, la fin d’année pourrait apporter un surcroît d’activité : les fêtes de Noël et le Jour de l’An sont traditionnellement synonymes de dîners festifs, de repas d’entreprise et de sorties en famille.
Après des mois de restriction, une partie des consommateurs aura peut-être envie de se faire plaisir au restaurant pour les occasions spéciales de décembre. Par ailleurs, l’inflation tend à ralentir en cette fin 2025 (avec une baisse récente des prix de l’énergie notamment), ce qui pourrait redonner un peu d’oxygène au budget loisirs des ménages. Si le pouvoir d’achat se stabilise ou augmente légèrement, la fréquentation des restaurants en France pourrait s’en ressentir positivement. De plus, les beaux jours de l’« arrière-saison » ont montré qu’avec une météo favorable et une offre adaptée, la clientèle répond présente : le pic de Toussaint a vraiment fait du bien aux établissements qui sont restés ouverts, même si ce n’était qu’un répit momentané.
D’un autre côté, la prudence domine chez les professionnels interrogés. « On espère tous que la tendance va s’inverser, mais rien n’est moins sûr », confie un patron de bistrot, qui anticipe un hiver en demi-teinte malgré les événements festifs. Beaucoup redoutent en effet un début 2026 encore difficile, marqué par le creux de janvier-février où la clientèle est historiquement moins nombreuse. Les trésoreries entamées durant 2025 risquent d’être mises à rude épreuve si la fréquentation ne rebondit pas significativement. Le mot d’ordre est donc d’avancer avec prudence, en continuant les efforts d’adaptation engagés. Maintenir des prix contenus malgré l’inflation, proposer des expériences originales (animations, soirées à thème, menus de saison attractifs) et communiquer positivement seront autant de clés pour attirer les clients malgré le contexte. Le secteur reste résilient : rappelons qu’il représente toujours un poids économique majeur (147 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023) et fait partie intégrante de l’art de vivre français.
En résumé..
En conclusion, la rentrée septembre-octobre 2025 n’a pas été le grand rebond espéré pour la fréquentation des restaurants traditionnels en France, mais une stabilisation semble s’opérer après un été médiocre.
Le tableau reste nuancé : certaines régions et certains formats de restauration tirent leur épingle du jeu, tandis que d’autres peinent à reconquérir les clients perdus. La profession fait preuve de résilience et d’inventivité pour s’adapter aux nouvelles attentes d’une clientèle plus rare mais plus exigeante. Les prochains mois seront déterminants : une amélioration durable de la fréquentation des restaurants passera sans doute par un contexte économique plus favorable, mais aussi par la capacité des restaurateurs à innover, se différencier et offrir le meilleur rapport qualité-prix possible.
C’est à ce prix que les Français renoueront pleinement avec le plaisir simple (mais essentiel) d’une bonne table partagée au restaurant.
Retour à la liste des articles